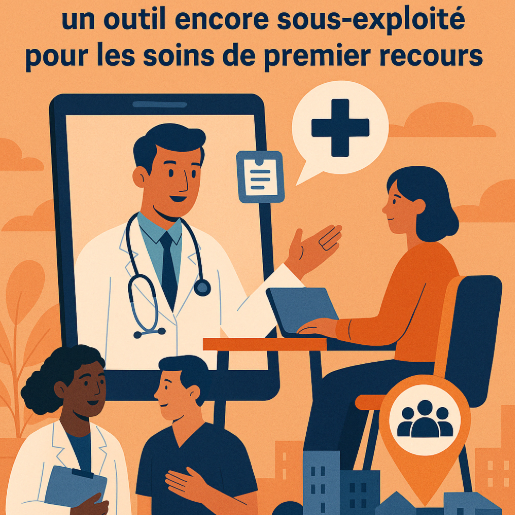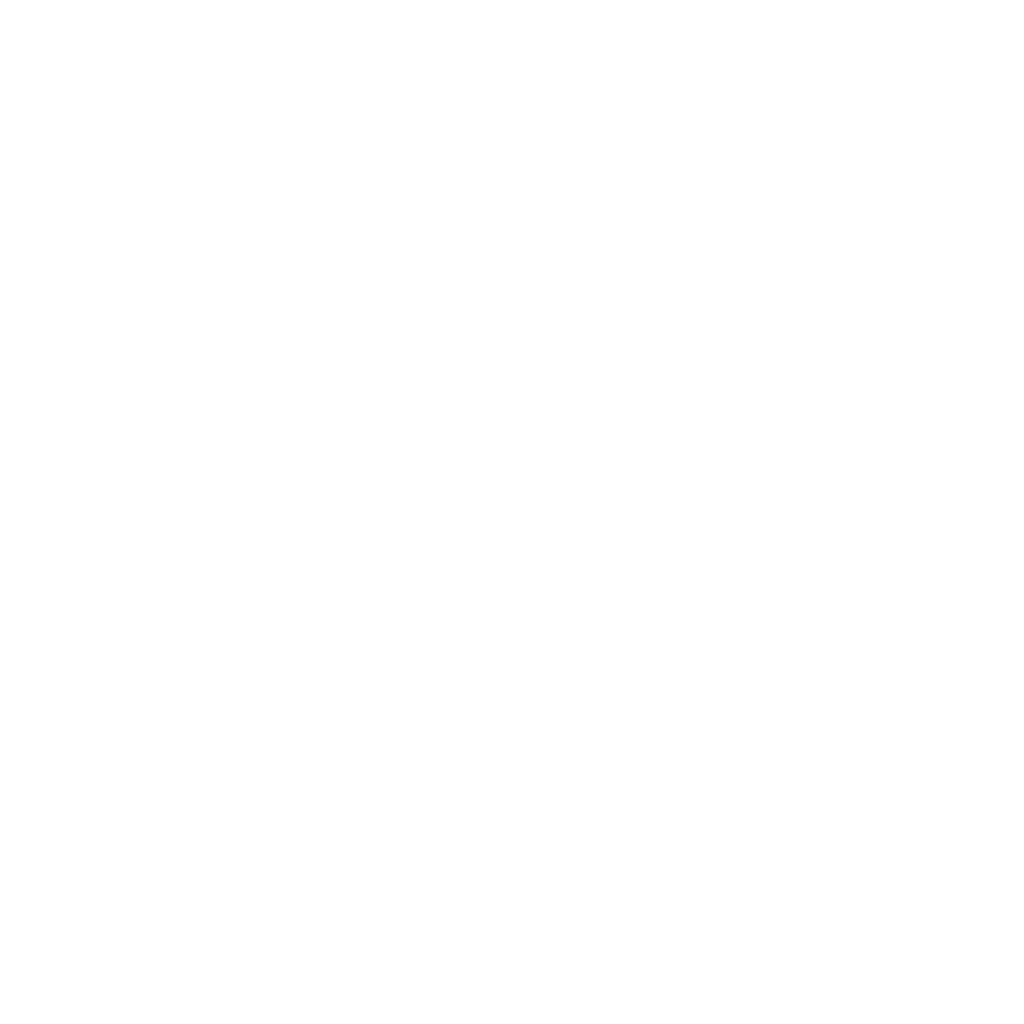La Cour des comptes publie en novembre 2025 son rapport intitulé « Les aides à l’installation des médecins libéraux ». Elle y dresse un constat sévère : si ces aides pèsent, pour l’année 2023, environ 205 millions € pour quelque 17 000 bénéficiaires ; elles ne semblent pas à la hauteur des enjeux d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés.
Au moins quinze dispositifs d’aides (aides directes, exonérations fiscales, etc.) se superposent : « un enchevêtrement d’aides de natures différentes (…) émanant de divers prescripteurs et insuffisamment pilotées ».
Un phénomène d’« effets de bord et de forte concentration des aides » : certaines zones non prioritaires bénéficient des dispositifs alors même que d’autres restent fragiles.
Et surtout, la Cour note que « la qualité de l’environnement professionnel pèse davantage dans les décisions d’installation que les avantages financiers ».
Enfin, l’efficacité de ces dispositifs est jugée très limitée : « isoler une aide financière n’a d’effet significatif que lorsqu’elle intervient dans un contexte … d’exercice collectif , notamment via les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ».
Pour résumer : le modèle classique d’incitation par des aides à l’installation, sans condition forte de coordination de l’exercice, révèle ses limites. Dans un contexte de rarification des ressources budgétaires, il est préoccupant de constater que la pertinence du fléchage des crédits du système de santé, actuellement débattus par le législateurs au sein du PLFSS 2026, n’est pas au rendez-vous.
Quelques facteurs identifiés par la Cour :
Les zonages d’éligibilité sont très larges : pour les médecins, les zones dites ZIP (zones d’intervention prioritaire) ou ZAC (zones d’action complémentaire) couvrent à elles seules jusqu’à 72 % de la population française selon le rapport.
Les zonages de type économique (zones FRR, ZFU) sont aussi mobilisés pour les médecins alors que leur logique n’est pas médicale : la Cour estime que « leur suppression permettrait de réaffecter des moyens vers l’exercice collectif en MSP ».
Le pilotage et le contrôle sont insuffisants : peu de données fiables sur le respect des engagements, coûts de gestion mal maîtrisés, superpositions entre dispositifs.
Le critère financier est secondaire dans le choix d’installation : les jeunes médecins accordent plus d’importance à l’environnement professionnel, à la charge de travail, à l’exercice en groupe, à la pluridisciplinarité.

Pour notre région — où l’accès aux soins reste un enjeu majeur — ce rapport rappelle que simplement multiplier les aides à l’installation ne suffit pas à garantir une couverture satisfaisante. Au contraire, l’orientation des aides, notamment financières doit être flêchée vers les équipes de soins coordonnés et les outils qu’elles tentent de déployer, comme par exemple les protocoles de coopération dont le modèle économique actuel ne permet pas la généralisation.
Quelques données probantes
Une étude de la DREES montre qu’entre 2008 et 2020, les généralistes exerçant dans une MSP voyaient leur patientèle croître plus vite que leurs homologues en exercice isolé ; cette progression ne s’est pas faite au détriment de la qualité.
Le « Plan 4 000 MSP » du ministère des Solidarités et de la Santé précise qu’un médecin en MSP voit en moyenne 600 patients de plus par an qu’en exercice isolé.
Sur le terrain organisationnel, les MSP permettent d’ancrer et maintenir durablement l’offre de soins via la pluriprofessionnalité, l’exercice collectif, la coordination, et une meilleure attractivité pour les jeunes professionnels, médecins et autres