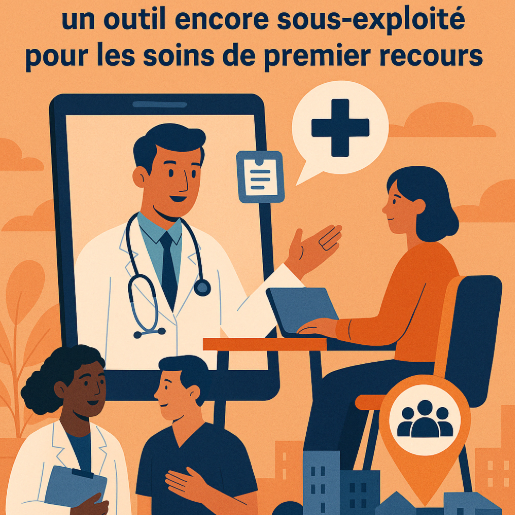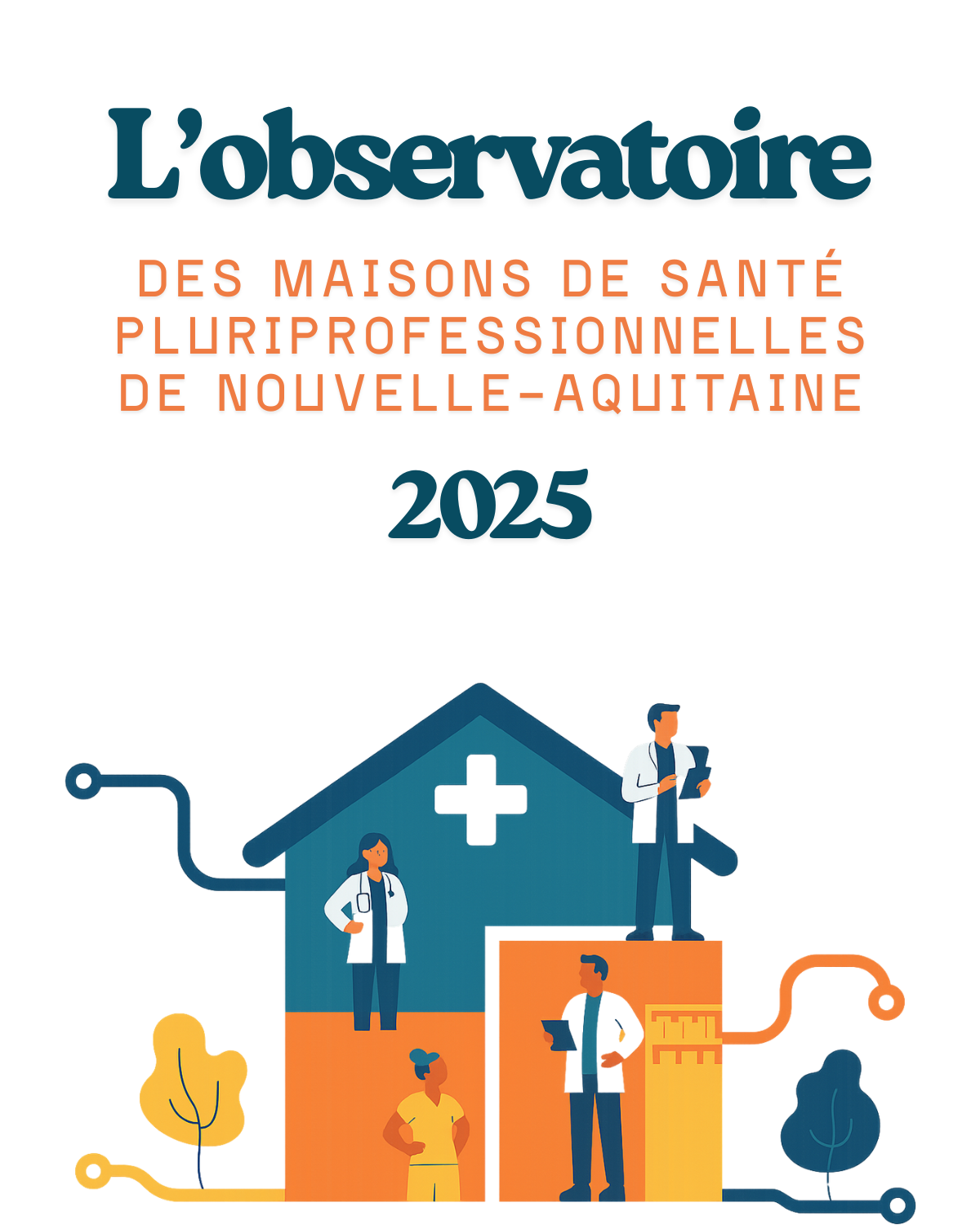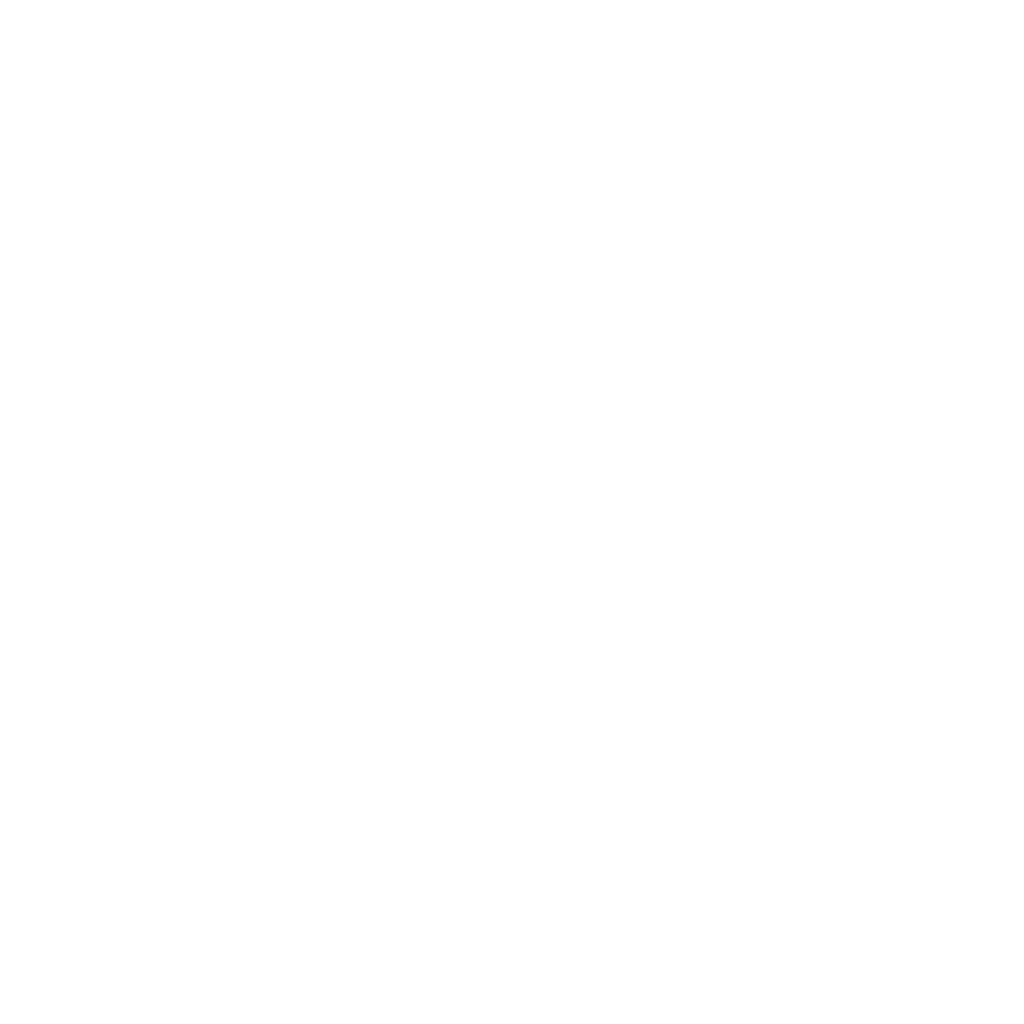Un levier sous-utilisé malgré un potentiel reconnu
Dans son rapport d’avril 2025 diffusé il y a quelques jours, la Cour des comptes dresse un état des lieux sans concession de la place des téléconsultations dans notre système de santé. Si ces consultations à distance sont officiellement intégrées dans le droit commun depuis 2018, elles peinent à trouver leur juste place dans la pratique quotidienne des soins de premier recours. En 2023, elles ne représentaient que 2,2 % de l’activité des généralistes et 2,1 % de celle des spécialistes libéraux. Ce faible taux d’intégration contraste avec leur essor pendant la pandémie de COVID-19, période durant laquelle elles avaient prouvé leur utilité pour garantir la continuité des soins. Rappelons tout de même que durant cette phase aigue de crise, les appels téléphoniques entre médecins et patients pouvaient être qualifiées d’actes de télémédecine, ce qui n’est plus le cas.
Une intégration marginale dans l’exercice coordonné
Le rapport souligne que les structures d’exercice coordonné — MSP, ESP, centres de santé — n’ont pas encore pleinement investi le champ de la téléconsultation. Pourtant, leur fonctionnement en équipe pourrait en faire un vecteur naturel de développement. En septembre 2024, seules 37 structures étaient référencées comme habilitées à gérer les exceptions au parcours de soins en téléconsultation, dans un pays qui compte plus de 100 départements. La quasi-absence de financement fléché et d’indicateurs dans les accords interprofessionnels (ACI MSP) en est une cause majeure.
Pour les professionnels de terrain, ce constat peut sembler paradoxal : comment attendre des MSP qu’elles contribuent au déploiement de la télémédecine sans accompagnement concret ni reconnaissance de leur rôle spécifique ?
Un axe de travail d’AVECSanté Nouvelle-Aquitaine
Pour tenter de pallier à cette appropriation trop lente, notre fédération démultiplie les incitations; Une formation “Télésanté” qui permet aux professionnels d’appréhender le cadre de pratique de ces nouvellkes techniques de soins, guides “téléexpertise”… L’ensemble de ces outils étant développés sous un angle pluriprofessionnel.
Un usage concentré… là où on l’attend le moins
Le profil type du patient téléconsultant reste éloigné des priorités de santé publique : jeune, urbain, connecté, souvent francilien. Plus de 50 % des téléconsultations sont réalisées en Île-de-France. Les publics visés — personnes âgées, handicapées, en ALD, résidant en zones sous-denses — y recourent peu. Cela renforce l’inquiétude d’un outil qui, au lieu de réduire les inégalités, pourrait en créer de nouvelles.
Cependant, des signaux intéressants émergent : les plateformes de téléconsultation semblent offrir une solution de recours pour des patients sans médecin traitant ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Elles mériteraient d’être mieux intégrées au dispositif national, à condition que leur activité soit encadrée et coordonnée #avec les acteurs de terrain.
Des perspectives pour les équipes de soins primaires
Le rapport invite clairement à une relance stratégique, notamment via :
un ciblage des aides à l’équipement sur les zones sous-dotées ;
un assouplissement du cadre juridique pour les patients sans médecin traitant ;
une meilleure valorisation de l’accompagnement infirmier à la téléconsultation (téléconsultation assistée) ;
et surtout, une clarification des objectifs de santé publique associés à ces actes.
Pour les MSP, cela représente une opportunité : celle de (re)prendre la main sur un outil qui peut améliorer la qualité des parcours, désengorger les urgences, et fluidifier la coordination avec le médico-social. Encore faut-il que les modalités soient adaptées à leur réalité de terrain et que les incitations soient concrètes.
De la promesse à la pratique?
Les téléconsultations ne sont pas la solution ultime pour améliorer l’accès aux soins. Mais bien utilisées en complémentarité avec les leviers déja connus par nos équipes de soin coordonnées, elles peuvent compléter utilement une offre de soins territorialisée, centrée sur l’équipe et les besoins réels de la population. Pour les maisons de santé, c’est une invitation à s’emparer de cet outil et à participer activement à la redéfinition de ses usages.